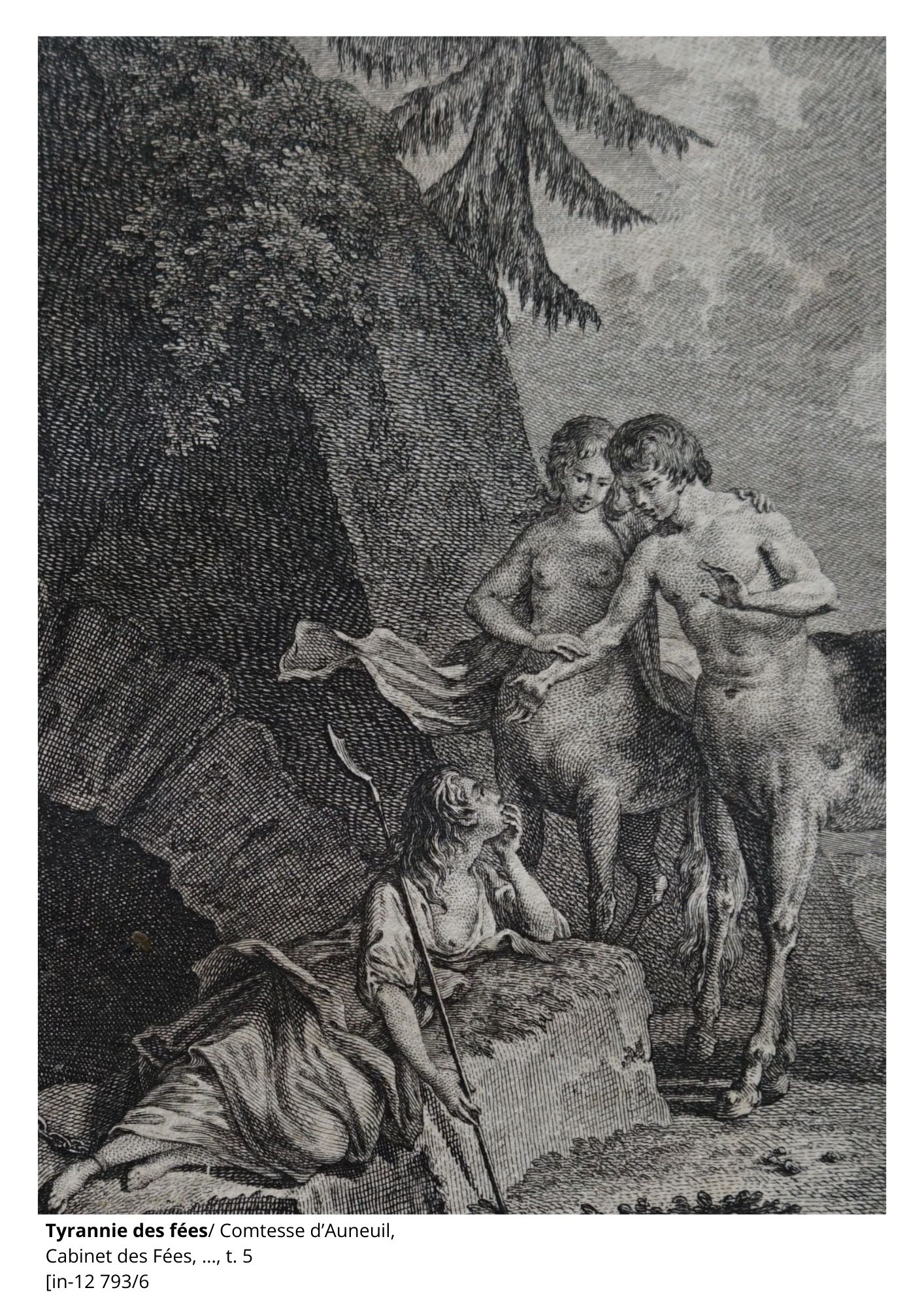 L’époque voit aussi l’émergence d’une querelle dans le monde littéraire. Les Anciens, partisans de l’héritage antique, affrontent les Modernes qui affirment que les écrivains français du XVIIe siècle ont fait mieux que ceux de l’Antiquité. C’est justement parmi les milieux mondains et féminins, partisans des Modernes, que la mode des contes de fées se développe.
L’époque voit aussi l’émergence d’une querelle dans le monde littéraire. Les Anciens, partisans de l’héritage antique, affrontent les Modernes qui affirment que les écrivains français du XVIIe siècle ont fait mieux que ceux de l’Antiquité. C’est justement parmi les milieux mondains et féminins, partisans des Modernes, que la mode des contes de fées se développe.
 Ainsi, l’engouement pour les cntes de fées pourrait être une stratégie des Modernes pour réhabiliter le folklore national et médiéval contre les Anciens fidèles à l’héritage antique. Ces récits viennent à point nommé pour appuyer le Parallèle des Anciens et des Modernes de Charles Perrault, démontrant que les contes « que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants » sont plus moraux que ceux de l’Antiquité.
Ainsi, l’engouement pour les cntes de fées pourrait être une stratégie des Modernes pour réhabiliter le folklore national et médiéval contre les Anciens fidèles à l’héritage antique. Ces récits viennent à point nommé pour appuyer le Parallèle des Anciens et des Modernes de Charles Perrault, démontrant que les contes « que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants » sont plus moraux que ceux de l’Antiquité.
À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle l’engouement des contes de fées s’essouffle. La parution en 1702 de La Tyrannie des fées détruite de Madame d’Auneuil est comme un adieu, tandis que la parution des contes orientaux des Milles et une nuits par Antoine Galland, crée l’engouement pour le merveilleux exotique.
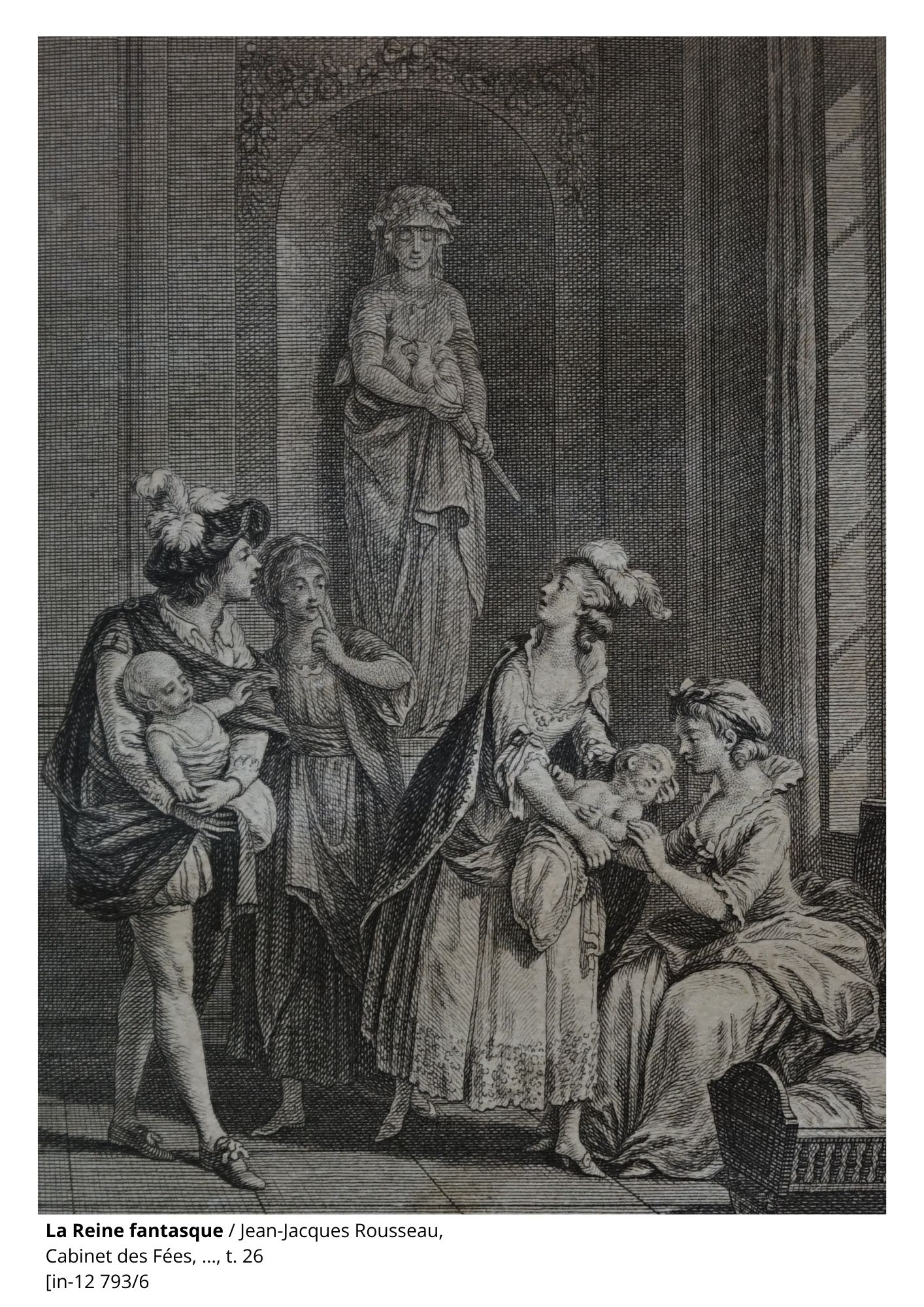 À partir de 1730 et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle le conte de fées connaît un regain d’intérêt. Il est alors une sorte de jeu pour tromper l’ennui ; même Jean-Jacques Rousseau s’essaie à l’exercice avec La Reine Fantasque. Les contes permettent d’exhiber sa connaissance de la langue avant de devenir, avec Madame Leprince de Beaumont, pédagogiques et moraux. Les éditions du XVIIIe siècle projettent sur les contes les préoccupations et les goûts de leur temps : le moralisme et la didactique, ou la découverte du charme du sentiment.
À partir de 1730 et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle le conte de fées connaît un regain d’intérêt. Il est alors une sorte de jeu pour tromper l’ennui ; même Jean-Jacques Rousseau s’essaie à l’exercice avec La Reine Fantasque. Les contes permettent d’exhiber sa connaissance de la langue avant de devenir, avec Madame Leprince de Beaumont, pédagogiques et moraux. Les éditions du XVIIIe siècle projettent sur les contes les préoccupations et les goûts de leur temps : le moralisme et la didactique, ou la découverte du charme du sentiment.
C’est entre 1785 et 1789 que Le Cabinet des fées, ou Collection choisie des contes de fées et autres contes merveilleux paraît. Ce recueil, compilé par le chevalier Charles-Joseph Mayer est composé de quarante et un tomes. L’époque est marquée par le goût des collections de livres ou de bibliothèques toutes faites disponibles par souscription. L’ouvrage est un succès qui conduit à publier une seconde édition afin de répondre à l’empressement du public.
Avec Le Cabinet des fées, Mayer réalise une compilation de contes de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le but de les préserver de l’oubli à un moment où l’on a cessé d’en écrire et d’en publier. Le Chevalier de Mayer indique lui-même dans son « Discours préliminaire » que « nous touchons au déclin du genre ». Il s’inscrit dans l’esprit des sommes intellectuelles et littéraires, proche de celui de l’Encyclopédie. Il rassemble ainsi des contes merveilleux ou sans éléments merveilleux, et sans distinction géographique : contes français, contes d’inspiration orientale, arabe, turque mais aussi indienne et chinoise. Sa sélection retient une quarantaine d’auteurs mais exclut les contes libertins et licencieux. Charles Perrault et Madame d’Aulnoy y occupent une place importante.
Cette compilation est la première entreprise scientifique de collecte des contes. L’éditeur y donne le premier essai de synthèse critique sur le conte merveilleux et ses origines ainsi que l’identification de cent un conteurs et leurs notices biographiques. Il fige aussi le conte de fées dans sa forme classique et rococo, imposant dans notre référent culturel les fées scintillantes et leurs robes étincelantes comme l’archétype du merveilleux.
.
Charles Joseph Mayer (1751-1825) est éditeur et polygraphe. Il écrit d’abord des pièces de théâtre, puis des romans et des compilations historiques. Il collabore au Mercure de France et à la publication de la Bibliothèque universelle des romans qui rassemble déjà de nombreux contes de fées, avant d’entreprendre la parution du Cabinet des fées, ou collections choisie des contes de fées ou autres contes merveilleux, de 1785 à 1789. Il s’associe alors avec Charles Georges Thomas Garnier, avocat et littérateur auxerrois (1746-1795), et fait publier son ouvrage par Gaspard-Joseph Cuchet (1750-1833).